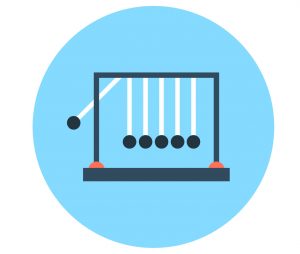 La recherche scientifique est une activité centrale de nos sociétés modernes. Son développement, au même titre que la production artistique, est considéré comme un élément fondamental de l’identité culturelle et de développement des civilisations. Aristote disait d’ailleurs : C’est par l’expérience que les sciences et l’art font leur progrès chez les hommes.
La recherche scientifique est une activité centrale de nos sociétés modernes. Son développement, au même titre que la production artistique, est considéré comme un élément fondamental de l’identité culturelle et de développement des civilisations. Aristote disait d’ailleurs : C’est par l’expérience que les sciences et l’art font leur progrès chez les hommes.
La notion de progrès – si chère en franc-maçonnerie – est naturellement la pierre angulaire de toute démarche scientifique. Les innovations technologiques qui en découlent sont devenues de nos jours par un enjeu politique et économique dans la compétition directe entre les nations ou les grandes entreprises.
La science est aussi source de grande controverse par les oppositions parfois violentes qu’elle génère à propos de questions morales et éthiques. Elle soulève également – preuves scientifiques à l’appui – des contradictions à l’encontre des dogmes religieux.
L’augmentation de la connaissance est une valeur louable en soi, mais certaines questions morales soulevées par une innovation nécessitent des justifications solides pour trouver une légitimité. Et même parmi les chercheurs toutes les pratiques scientifiques ne font pas l’unanimité. Il devient de plus en plus nécessaire d’encadrer l’expérimentation par des textes contraignants. La société cherche donc des compromis pour obtenir le maximum de bénéfices du développement technologique tout en prenant en compte certains des avis et valeurs éthiques de l’époque.
Deux intérêts fondamentaux semblent donc converger : la société qui dépend de la recherche scientifique pour son développement, et la science qui n’est pérenne qu’avec le soutien financier des états et/ou de l’investissement privé. Or la majorité des scientifiques actuels ne sont pas formés à la vulgarisation à destination du grand public. De puissants lobbies sont souvent les intermédiaires entre la science, l’homme de la rue et les décideurs. Ces groupes de pressions soutiennent parfois les activités innovantes, mais parfois aussi dénoncent certaines recherches, à tord ou à raison. Néanmoins, on observe dans l’ensemble du monde occidental une ouverture favorable à l’esprit scientifique de plus en plus organisée et une sensibilisation des chercheurs à la communication.
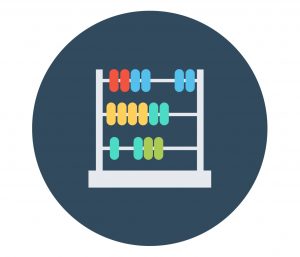
D’un point de vue historique et même géographique, on observe un spectre extrêmement large de cas d’interactions entre science et société. Elles vont de la suspicion envers les scientifiques, mis
au banc de la société, à une intégration presque complice de l’activité scientifique qui est perçue comme une source de fierté nationale. Le sujet est extrêmement vaste. L’objectif de ce texte se
limitera à survoler un certain nombre d’évènements ou de périodes éclairant les rapports entre le monde scientifique et la société qui l’abrite.
Notre tradition scientifique occidentale prend ses origines dans la Grèce ancienne. Nous y avons puisé notre « méthode scientifique ». Selon Aristote : La science accroit la sagesse des hommes en prenant en compte ce qui les précède. La science a été très tôt regardée comme un élément central de développement des civilisations et comme un moyen de faire bénéficier la communauté des progrès qu’elle entraîne. Au sein de la civilisation gréco-romaine, l’architecture et l’ingénierie en particulier ont laissé de nombreux témoignages du bénéfice sociétal de l’application des technologies. Toutes les activités humaines étaient concernées, civiles mais aussi militaires comme en témoigne l’exemple de la défense de Syracuse par Archimède en 212 avant notre ère.
La chute de l’empire romain fait entrer l’Europe dans une période de plusieurs siècles de ralentissement des développements scientifiques. Instabilité et insécurité rendent les échanges complexes. Les savants deviennent quasi-exclusivement des membres de sociétés ecclésiastiques plus ou moins autarciques et fortifiées. Le monde religieux reste longtemps l’unique terreau possible du développement scientifique avec toutes les contraintes de dogme qui pèsent sur ses membres. L’ingénierie (au service de la guerre en particulier) et l’architecture (au service de la guerre comme du religieux) sont néanmoins concentrés dans des guildes de plus en plus organisées et indépendantes. En franc-maçonnerie, nous en tirons un héritage de symboles et un ancrage profond dans notre civilisation. Au moyen-âge néanmoins la religion catholique surveille la science d’un regard fortement suspicieux. Les trafics de cadavres par exemple, servant à étudier l’anatomie, sont punis par des peines atroces.
Dans le même temps, la civilisation arabe connaît un âge de lumière pendant lequel les connaissances fondamentales et leurs développements pratiques s’échangent. La première université arabe Al Quaraouiyine à Fès au Maroc voit le jour en 877. En Europe chrétienne apparaît l’école de médecine de Salerne dans le Mezzogiorno en Italie puis, deux siècles plus tard, l’université de Bologne suivie d’autres à partir du 12è siècle.
Dans la péninsule ibérique, le cas unique de Tolède est particulièrement intéressant puisqu’après sa reconquête par les chrétiens, les trois religions présentes (juive, chrétienne et musulmane) continuent de coexister et de partager des connaissances académiques. Cela nous renvoie à la notion de concorde universelle – si importante en franc-maçonnerie – où se confronter avec les idées des autres tout en les respectant est une condition fondamentale du progrès.
Malgré ce fleurissement de penseurs en Europe, l’intégrisme religieux, cristallisé dans la création de l’inquisition reste extrêmement contraignant pour le développement scientifique. La « croyance alternative » – même si la logique et l’expérimentation prouvent sa véracité – reste inacceptable si elle contredit l’interprétation officielle d’un texte sacré. C’est pourquoi les avancées scientifiques en Europe jusqu’à la renaissance restent principalement l’œuvre des « infidèles » – juifs ou musulmans – installés au delà de l’emprise politique des papes.
La renaissance offre progressivement à la science plus de liberté, même si on voit en 1633 avec le procès de Galilée que l’Europe catholique des lumières reste violemment réfractaire à toute découverte risquant de changer radicalement sa conception du monde.
A la fin de la renaissance, l’Europe commence à se scinder du point de vue de la religion, avec la traduction de la bible en langue vivante (début du 16è siècle par Martin Luther) et la remise en cause des incohérences entre le dogme religieux et le mode de vie des prélats. Soudainement, des états rejettent le catholicisme. Il faut donc pour les pays restés fidèles à Rome, se résoudre à interagir avec des « infidèles », accepter des échanges avec eux – commerciaux ou autres. De fait la pensée autorisée n’est plus une pensée universelle et unique. Des vérités alternatives voient le jour. D’autant que les états protestants se montrent dans l’ensemble beaucoup plus modernes dans leur organisation sociale. Les nobles fréquentent beaucoup plus les bourgeois, et la relation aux découvertes scientifiques y est moins intrusive. La propriété intellectuelle et la brevetabilité s’y développent de façon plus juste que les privilèges royaux octroyés de façon subjective par le Roi de France au travers de l’académie des sciences. Les découvertes se succèdent (imprimerie, microscopes, etc) ainsi qu’une volonté d’avancer vers des nomenclatures communes : les unités de mesure, ou la transcription par Lavoisier des symboles alchimiques en éléments chimiques unifiés (qui est déjà très proche de ce que fera bien plus tard Mendeleïev avec son tableau périodique des éléments).
Nous arrivons progressivement à une période que j’appellerai un âge « romantique » de la recherche scientifique. Les chercheurs sont relativement libres dans leurs travaux – qui sont jugés par leurs pairs au niveau international sur la base de présentations publiques et d’ouvrages écrits. Les pouvoirs politiques et religieux ne sont que peu ou plus contraignants.

La science du 19ème et du début du 20ème siècle se donne comme finalité le progrès du bien-être de l’humanité. Le testament d’Alfred Nobel (une personnalité par ailleurs très décriée de son vivant) semble en être l’apogée.
La première guerre mondiale montre une rupture profonde avec l’époque précédente. Les grandes puissances, empêtrées dans une guerre durable qui épuise leurs ressources, se mettent à chercher des solutions scientifiques à des problèmes de stratégie militaires. Fritz Haber est un exemple terrible de ce changement de paradigme. Par patriotisme, ce chimiste juif développe la chimie du chlore jusqu’à obtenir les premiers gaz de combat. Il est félicité par le Kaiser et obtient un an de salaire supplémentaire en remerciement de son invention. En 1918, c’est scandaleusement un prix Nobel qui lui est octroyé pour son travail scientifique sur les gaz chlorés. On oublie trop souvent son épouse, Clara Immerwahr, également chimiste, qui se suicide faute de pouvoir convaincre son mari de pratiquer la science dans le but d’aider l’humanité (information occultée par la propagande de guerre). Depuis lors, aucune guerre n’a été concevable sans un effort scientifique et technologique. Armes et sciences sont intimement liées aujourd’hui.
Globalement, les deux guerres mondiales ont privé la communauté scientifique du contrôle éthique et moral. Les scientifiques allemands en 1945 deviennent une sorte de trophée de guerre dont le partage est âprement négocié entre les vainqueurs. Beaucoup de ceux qui ont exercé un rôle inacceptable dans les camps de concentration sont intégrés aux communautés scientifiques des super-puissances. Leurs sociétés tutrices leur garantit le silence sur leurs méfaits en échange des applications de leurs recherches. Les scientifiques deviennent – souvent malgré eux – des outils idéologiques de la guerre froide. Au 20ème siècle, la politique a donc repris une forme de contrôle sur la science. La recherche fondamentale est souvent reléguée à une place secondaire. La dimension économique prend aussi une plus grande importance. Le politique et l’économique décident seuls des domaines de recherches prioritaires.
On a vu avec la récente épidémie d’Ébola à quel point cette maladie – dont on connaît le danger depuis longtemps – a été mal gérée ! Nous avons soudainement décidé de mettre en urgence des moyens de recherche pour sauver quelques infirmiers et médecins infectés… alors que des populations africaines en souffrent depuis des dizaines d’années. Il a fallu soudainement trouver un traitement en quelques mois ! Mais un investissement suffisant et de longue haleine pour répondre aux enjeux de santé publique peine malheureusement à exister face à la recherche de bénéfices immédiats dans la marchandisation des progrès. La solvabilité des populations que l’on choisit de soutenir – ou leur faible nombre dans le cas de maladies rares – prend le pas sur la recherche du bien commun.
Heureusement la société civile a tenté à plusieurs reprises de reprendre la main notamment sur les problèmes de santé individuels ou collectifs. L’émergence de la bioéthique comme discipline 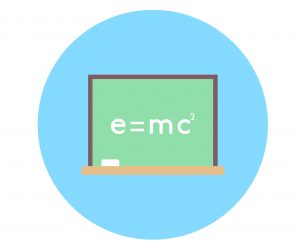 académique dans les années 70 ou la création d’immenses lobbies comme Greenpeace en sont la cristallisation. L’époque où la science – sous contrôle de la politique – était imposée à la société est révolue Les citoyens des pays occidentaux se retrouvent de plus en plus à encourager des solutions scientifiques à leurs problèmes. L’explosion des biotechnologies depuis les années 90 donne un climat ambigu qui mélange un certain intérêt pour les avancées médicales ou environnementales, ainsi qu’une méfiance vis-à-vis des abus (tel le débat sur les OGMs).
académique dans les années 70 ou la création d’immenses lobbies comme Greenpeace en sont la cristallisation. L’époque où la science – sous contrôle de la politique – était imposée à la société est révolue Les citoyens des pays occidentaux se retrouvent de plus en plus à encourager des solutions scientifiques à leurs problèmes. L’explosion des biotechnologies depuis les années 90 donne un climat ambigu qui mélange un certain intérêt pour les avancées médicales ou environnementales, ainsi qu’une méfiance vis-à-vis des abus (tel le débat sur les OGMs).
Mais la technologie avance bien plus vite que la loi, de même que la capacité de compréhension des citoyens. Elle engendre des clivages générationnels. En parallèle, certains lobbies sont en mal de causes à défendre puisqu’ils ont déjà gagné sur leurs revendications originelles. La suspicion qui va de pair avec le rythme effréné des découvertes scientifiques est un terrain favorable pour préserver le pouvoir d’influence qui est devenu la raison d’être de ces lobbies. Dans mon expérience personnelle sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, les deux opposants les plus virulents aux développements médicaux dont j’étais le promoteur étaient le Vatican (fidèle à son dogme sur le respect de la vie humaine à tout stade de développement) et Greenpeace-Allemagne (qui était le porte-parole du public allemand traumatisé par les recherches sur l’humain au cours de la seconde guerre mondiale).
Nombreuses ont été les publications concernant les problèmes climatiques. La sphère politique – poussée par la pression associative et citoyenne – commence à s’approprier le sujet. On a observé également plusieurs cas intéressants où la recherche prenait le premier rôle. Le mouvement français « sauvons la recherche » en 2003, suivi par 2/3 du personnel scientifique du pays (soit 74 000 chercheurs) et plus de 230 000 citoyens est une formidable illustration de ce phénomène.
La campagne présidentielle française de 2007 a vu un candidat indépendant (à l’époque) regrouper beaucoup de scientifiques autour de sa candidature et imposer aux autres l’adhésion à une charte environnementale : Nicolas Hulot.
Il est impossible aujourd’hui de savoir comment vont évoluer les rapports entre science et société dans le monde occidental, mais il semble évident que la science – longtemps mise sous la tutelle du politique – gagne en indépendance et en soutien populaire. Devenir un citoyen averti suppose aujourd’hui de s’intéresser à de nombreux sujets en particulier scientifiques. Le législateur est également sollicité comme en témoigne les révisions des lois françaises de bioéthique en 2011 et 2013.
C’est encore une minorité des citoyens qui s’équipe des outils et des connaissances nécessaires pour exercer ce rôle d’observateur vigilant, mais c’est loin d’être une quantité négligeable. Les francs-maçons font partie de ceux-là. Nous avons tous un rôle à jouer pour restituer les valeurs morales dans des pratiques aujourd’hui déshumanisées. Pour citer un exemple, il s’agit de faire condamner la biopiraterie, c’est-à-dire le fait de s’approprier par brevet des connaissances pharmacologiques ancestrales de peuples de tradition orale.
Pour conclure, il est certain qu’un cadre précis est nécessaire à l’expérimentation scientifique, ce qui est en général demandé par les chercheurs. Mais un contrôle exclusif de ces limites par le politique ou par la société civile ou par les chercheurs est un point de départ aux abus les plus graves. Le contrôle doit être partagé et capable d’évoluer. Figer les pratiques dans un cadre immuable et déconnecté de l’évolution de la société serait la mort du progrès.